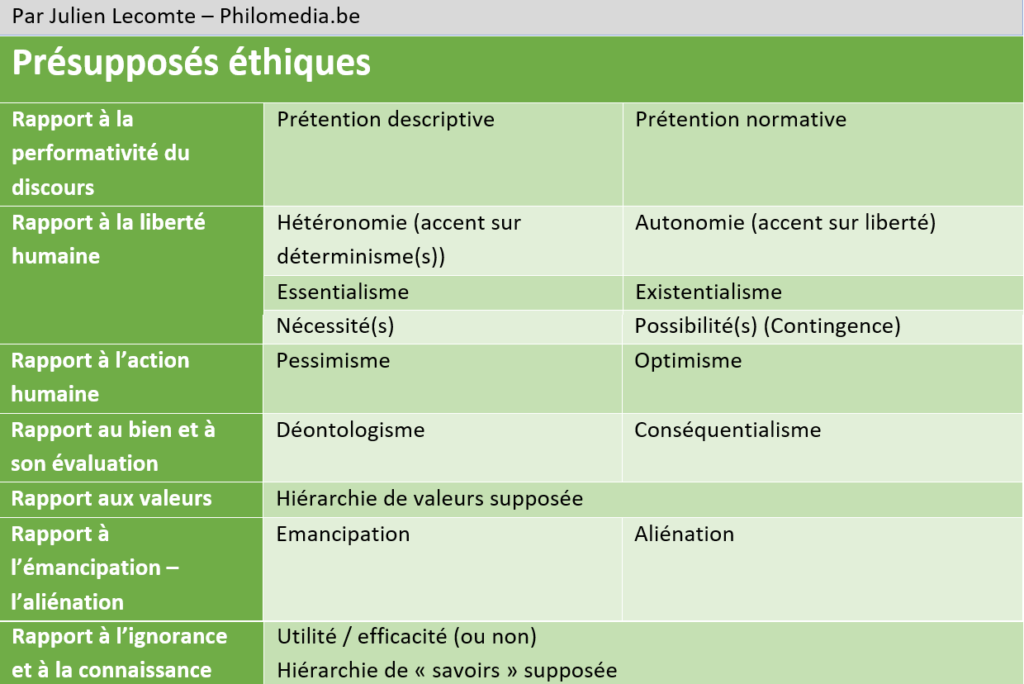« Notre ennemi, c’est notre maître » – Illustration du livre Le Principe Anarchiste de Pierre Kropotkine (1913)
Exemples de présupposés moraux dans des pratiques éducatives
Existentialisme, étiquetage et pari d’éducabilité
Si l’on considère que toute personne peut changer, s’élever de sa « condition » actuelle, alors elle peut être éduquée. Il n’y a pas de « cas désespéré », mais des situations et comportements difficiles. Ce parti-pris existentialiste correspond également à une posture optimiste en éducation.
Une des conséquences primordiales en éducation de l’existentialisme est de prendre garde au phénomène d’étiquetage, véritable réification de l’individu, et de faire un pari d’éducabilité : un élève n’est pas un « mauvais élève », « bête » et « méchant » une fois pour toutes.
Les dynamiques psychologiques et sociales de stigmatisation (Cf. Paugam, Goffman…) montrent d’ailleurs que l’attribution de caractéristiques ou l’expression de croyances peuvent influencer les comportements des individus, voire leur développement.
Un présupposé systémique dans un groupe, en lien avec l’existentialisme, consiste à distinguer la personne de ses comportements (et a fortiori de ses performances). Les actes des individus ont lieu dans un contexte d’interactions, avec des rôles, des dynamiques spécifiques. Dans une classe, par exemple, il existe des règles, des normes et des rôles explicites, mais aussi des dynamiques implicites : tel élève peut ainsi se montrer calme en présence d’un élève au comportement perturbateur, puis revêtir lui-même ce rôle en l’absence du premier. Une des implications de la pensée systémique consiste à ne pas réifier une personne à un comportement que celle-ci adopte en contexte, même si celui-ci est répété.
Radicalisée, la pensée systémique peut représenter une sorte de déterminisme social. En effet, si tous les comportements (et leurs conséquences) dépendent du système, du contexte, alors les individus ne sont pas vraiment libres de les adopter ou non. Ils n’en sont pas responsables.
Entre autonomie et hétéronomie
Citoyenneté et droits de l’homme
La citoyenneté dite « active » est régulièrement caractérisée en termes d’autonomie, de jugement critique, de responsabilité, ainsi que de solidarité. Il s’agit non seulement d’un « état » de citoyen, mais aussi d’une posture supposant l’exercice d’une certaine liberté. Le développement de ce type de citoyenneté est un objectif revendiqué de l’éducation, et a fortiori de l’éducation aux médias.
En général, l’inscription des cours liés à la citoyenneté dans le contexte de la société des droits de l’homme représente un positionnement par rapport au relativisme moral (il existe des valeurs et des droits qui priment sur d’autres types de mœurs), éventuellement pour une certaine forme de déontologisme (existence de droits, devoirs, règles et sanctions « immuables », « absolus »).
Par ce biais, l’enseignement procède d’une prise de position contre le relativisme des valeurs (toutes les activités éducatives ne se valent pas, tous les comportements des usagers des médias ne se valent pas, etc.), pour l’existentialisme modéré (l’émancipation correspond à l’exercice d’une autonomie, avec insistance sur la place de la responsabilité) dans le cadre de la finitude humaine. Il peut revêtir une fonction de remise en cause nuancée de la morale (au regard des droits de l’homme) au sens des conventions instituées, contre les aliénations possibles de manière générale.
Valeurs et règles, entre obligations (devoirs) et choix conscients
La référence aux droits de l’homme suggère implicitement qu’il existe des valeurs universelles, un socle de lois morales « immuables » à la société. L’éducation consisterait en ce sens à transmettre des valeurs et des règles (obligations, interdits…) qui en découlent.
L’exemple du « non » au jeune enfant illustre un tel apprentissage des limites, des interdits (souvent, au nom de sa sécurité)… Dans ce cas, la loi est imposée de l’extérieur. Ce type d’apprentissage est-il possible autrement ? Peut-on se dispenser d’un tel présupposé paternaliste ?
En éducation, la « recette du bâton et de la carotte » semble avoir attesté de son utilité (et de son efficacité) dans une certaine mesure. C’est le cas de l’évaluation, notamment. S’il est possible de procéder selon des méthodes axées davantage sur la motivation des étudiants, la note demeure une manière utilisée par beaucoup une manière de « tenir » leur classe. Est-ce possible autrement ?
Dès lors, il est possible de relever une contradiction apparente entre le fait de poser des interdits ou obligations et le développement de l’autonomie. Comment responsabiliser ?
Une tension entre liberté et « sécurité » peut également être soulignée. Comme dans le cas du jeune enfant dont on estime qu’il ne dispose pas de suffisamment d’autonomie pour lui donner le choix, la sécurité (entendue en quelque sorte comme résultat du respect de sa propre intégrité physique, mentale, ou de l’intégrité de la collectivité) est utilisée pour justifier d’un amoindrissement de la liberté. Autrement dit, cela consiste à poser que puisque l’individu ne peut se rendre responsable de ses actes et décisions, il faut les lui imposer.
Les interdits et obligations sont cependant régulièrement considérés comme des repères insuffisants. D’abord, ils n’empêchent pas à eux seuls la présence de transgressions. De plus, certains d’entre eux sont évolutifs, changeants. Ensuite, lorsqu’il est question de l’application de règles et de sanctions, les conséquences et le contexte peuvent être pris en compte, de manière à responsabiliser la personne (on parle de « sanctions réparatrices »). Enfin, ils ne représentent pas les seules manières de susciter l’action (enjeu de la motivation, par exemple), et par extension de contribuer au développement d’une société harmonieuse.
L’éducation apparait alors comme un travail parallèle sur les deux plans : ne se contentant pas de règles immuables qui transcenderaient l’individu (une action est bonne parce qu’elle correspond aux règles), elle tâche de développer progressivement l’autonomie tout en le situant dans un contexte social qui le précède (une action est bonne parce qu’elle prend en compte les conséquences selon différents paramètres). Parallèlement à l’apprentissage de lois, il s’agit également d’apprendre à les choisir après analyse critique.
Paradoxe et risque de l’enseignement de la « pensée critique » : « J’attends de vous tous que vous soyez des penseurs indépendants, innovants et critiques qui font exactement ce que je dis ! » Source : https://theness.com/neurologicablog/index.php/the-need-for-critical-thinking/
Vers un nihilisme méthodologique a priori ?
Une position nihiliste méthodologique en éducation suppose de partir du principe que tel ou tel savoir ne sert à rien, qu’il n’a pas de valeur ou n’est pas important a priori.
C’est une posture que prennent d’ailleurs certains apprenants face aux contenus éducatifs desquels ils ne perçoivent pas les enjeux ; ce serait une erreur didactique de leur en tenir rigueur.
Face à cette assertion, il convient pour le pédagogue de trouver ce qui peut faire sens, non seulement pour soi-même en tant qu’enseignant, mais aussi pour les apprenants. Quitte à réaliser que son postulat sévère se vérifie parfois dans une certaine mesure ? Il s’agit de remettre en cause (les fondements, le sens et la signification de) sa pratique ; de praxéologie.
Il ne s’agit pas d’un nihilisme absolu, mais bien d’une posture provisoire, méthodologique. Le nihilisme méthodologique consiste à considérer de manière provisoire le point de vue selon lequel tel ou tel contenu d’enseignement n’a pas plus de valeur qu’un autre, et qu’il n’y a donc aucun sens à enseigner celui-là en particulier.
Études de cas possibles : « quels sont les présupposés épistémologiques et moraux dans tel ou tel dispositif pédagogique » ? Ou encore, par exemple, dans les émissions « Retour au pensionnat », « Pascal, le grand frère », « Super Nanny »… Ou encore Quelle hiérarchisation des valeurs implicite ?
Exemples de présupposés moraux dans des pratiques journalistiques
Tension entre émancipation et aliénation : les médias comme contre-pouvoir
Traditionnellement, les médias sont envisagés comme vecteurs d’émancipation, de liberté, d’égalité des chances (versus aliénation). Il s’agit en quelque sorte d’un héritage de la Modernité : la presse représente un contre-pouvoir par rapport à un système institué.

La Libre Belgique clandestine (Peter Pan), 1942.
Les médias ont une fonction démocratique par rapport à l’espace public : la sphère publique est réappropriée par les individus. Cela devient le lieu du débat rationnel, de la critique, par opposition à un contrôle totalitaire (cf. Habermas). Certains journalistes se présentent parfois comme des « missionnaires » par rapport à cet idéal.
Depuis, une tendance existante consiste à considérer implicitement l’éducation aux médias comme un contre-pouvoir « face » aux médias. Dès lors, ceux-ci ne seraient plus « du coté » de l’émancipation, mais de l’aliénation. Dans la plupart des dispositifs éducatifs ou politiques, les médias sont considérés en fonction de cette tension entre émancipation et aliénation.
Fonctions des médias et valorisations de celles-ci
Plusieurs fonctions des médias peuvent être épinglées :
- Divertissement (plaisir, bonheur) ; épicurisme, hédonisme et leurs réinterprétations contemporaines
- Socialisation (voire cohésion sociale)
- Information, voire action qui en découle (vérité, liberté)
- Esthétique (beauté)
- …
Régulièrement, dans les contenus médiatiques ou les analyses qui en sont faites, une ou plusieurs valeurs sont mises en avant au détriment d’autres.
Une tendance idéologique consiste à attribuer plus de valeur à l’information en tant que telle qu’à la socialisation ou au plaisir que celle-ci peut susciter. La référence pour juger est alors le « savoir académique », la connaissance « noble ».
Ces fonctions des médias sont parfois réifiées à un moyen déconnecté d’une finalité consciente (par exemple, faire du profit, faire de l’audience…).
Journalisme, règles et déontologie
La déontologie occupe une place relative en journalisme :
- Elle est à situer par rapport aux éthiques individuelles (principes de chacun) des journalistes et à la régulation (règles imposées de l’extérieur). Le journalisme est en effet soumis à des droits, devoirs et obligations génériques : cadre de la liberté d’expression, etc.
- Boris Libois : l’autorégulation est une tautologie dans le domaine du journalisme. Elle correspond à la liberté de la presse (autonome, indépendante, elle se donne ses propres lois).
- Marc de Haan : la déontologie ouvre un espace de réflexion. Il s’agit de se mettre d’accord entre pairs sur des repères moraux pour le journalisme.
En général, l’éthique de la communication en tant que discipline spécifique (promotionnelle, marketing, publicitaire) se traduit en éthiques normatives (choix de valeurs et d’actions concrètes en conséquence).
Certains accordent de l’importance au « fact checking » et à certaines méthodes d’investigation journalistiques (sans manquer le présupposé des « faits vrais », cf. Présupposés épistémologiques en journalisme) tandis que pour d’autres, ce qui compte, c’est l’émulation sociale (le « buzz »).
Des codes et conventions journalistiques peuvent être constatés en filigranes des pratiques. Leurs visées sont multiples : être compris (clarté, questions de vulgarisation), susciter le désir / la consommation, etc.
Notons enfin que la réflexion déontologique appliquée aux médias implique le fait de prendre en compte le récepteur, ses attentes, ses représentations mentales et les effets des contenus, non seulement les contenus en tant que tels. Il s’agit d’interroger les responsabilités par rapport aux publics, au contexte social, et non seulement les messages communiqués (Cf. . La déontologie n’est pas uniquement une question de sémantique, mais aussi de pragmatique. Cette considération rejoint l’idée du principe de coopération.